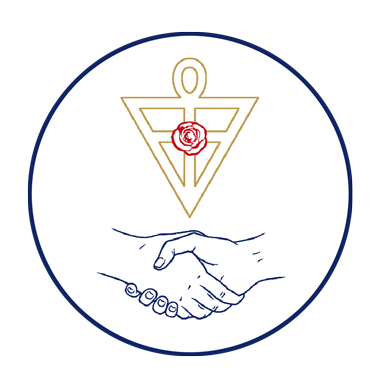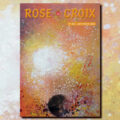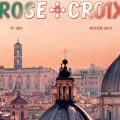- La renaissance de Notre-Dame, par S. Devaux
- Mythes : nature, origine et fonctions, par M. Sainte-Rose-Fanchine
- Dans nos mains, par F. Ramos
- Marie de Magdala Sacrée femme, Femme sacrée, par A. Gournet
- Notre rapport au temps, par Y. Gaborit
- Documents d’Archives de l’A.M.O.R.C. : Les Confessions de Napoléon
Article sélectionné dans ce numéro : N° 290 : Eté 2024
La renaissance de Notre-Dame
par Sylvain Devaux
Des volutes de fumée s’élèvent peu à peu dans le ciel parisien ce lundi 15 avril 2019. Puis ce sont les flammes et en toute fin de journée, le monde entier, stupéfait, voyait brûler la cathédrale Notre-Dame de Paris. L’incendie allait ainsi ravager la toiture de l’édifice avant que la flèche ne s’écroule, endommageant gravement la voûte de la croisée du transept. Un incendie qui sera finalement maîtrisé après quinze heures d’efforts incessants et c’est un déchirement lorsque les dégâts se font jour.
Immédiatement, la reconstruction de Notre-Dame sonne comme une évidence au plus haut sommet de l’État. Cette annonce a laissé place à de longs débats sur cette reconstruction, entre partisans d’une version moderne et restitution à l’identique. Notre-Dame est le fruit d’un complexe assemblage de différentes époques. Si l’aspect extérieur s’imposait finalement, serait-il semblable à l’édifice avant incendie, faut-il utiliser pour les parties non visibles comme la charpente, du béton comme à Reims ou du métal comme à Chartres ou tout autre matériau ? Faut-il utiliser du chêne comme à l’époque alors que les plus anciennes pièces auraient près de mille ans et que d’autres datent du XIXe siècle ? La décision tiendra à une conjonction de facteurs, mais le destin va donner ici un coup de pouce à l’histoire.
Revenons cinq ans en arrière, alors que deux architectes, Rémi Fromont et Cédric Trentesaux, préparent leur diplôme. Ils ont intégré la prestigieuse École de Chaillot afin de devenir architectes du patrimoine. Leur travail minutieux porte sur l’étude de la charpente de la nef et du cœur de Notre-Dame, ce qui, étonnamment, n’avait pas
encore été fait jusque-là. Ils vont ainsi répertorier les techniques de mise en œuvre, en particulier celles de la période médiévale. Un travail de fourmi de près d’une année, agrémenté de détails infiniment précieux et de dessins à main levée. Nous sommes cinq ans avant l’incendie et c’est au regard de ce travail admirable que se dessine l’idée d’une restitution à l’identique et non une reconstruction, sans doute inenvisageable autrement. Les architectes vont prendre alors conscience de la portée de leur travail. C’est aussi le point de départ d’un chantier hors normes.
L’Île de la Cité abritait des constructions romaines et au VIe siècle, Clovis, converti au catholicisme, y fit élever un premier édifice dédié à saint Étienne, révélé par des fouilles lors de travaux d’amélioration menés au XIXe siècle. Préalablement, le lieu était l’objet de cultes païens dont l’un serait dédié à la déesse Isis, Mère de l’alchimie. Une déesse égyptienne bien loin de ses terres, confisquées par les Romains, qui aurait donné, selon certains, le nom de la ville « Par Isis ». L’autre version, certes plus communément admise, fait appel au nom donné par les Romains aux habitants de l’ancienne Lutèce qu’ils conquirent au Ier siècle avant notre ère du nom de “urbs Parisiorum”, soit la ville des “Parisii”, un ancien peuple gaulois du IIIe siècle avant J.-C. Quelle qu’en soit l’interprétation, il n’en reste pas moins vrai que l’Île de la Cité est au cœur de la ville naissante.
Elle est aussi le cœur spirituel de cette ville qui se développe et Notre- Dame est appelée à en devenir le centre névralgique. Gui de Bazoches(1) évoquait l’Île de la Cité en 1190 comme étant « la tête, le cœur et la moelle de Paris ». La première pierre de cet immense ouvrage est posée en 1163 par l’influent évêque de Sully. Il fait alors appel aux meilleurs architectes maçons de l’époque. La dénomination d’architecte est quelque peu différente de celle d’aujourd’hui et consacre plutôt un travail de coordination des gens de l’art. Le chantier est d’une incroyable ampleur avec une longueur de 127 mètres, 40 de largeur et 33 de hauteur dans un style qui commence sur des bases romanes mais qui sera plus tard qualifié de gothique rayonnant. Il est vrai que la construction de l’ensemble prendra près de deux siècles pour cette cathédrale exceptionnelle.
Des modifications seront apportées à l’édifice au fil des siècles, aussi au regard de la mode qui rejettera le style gothique sous l’influence des artistes de la renaissance avant une lourde restauration au début du XVIIIe siècle. Puis ce sera une autre restauration menée au milieu du XIXe siècle par Eugène Viollet-le-Duc. Difficile de parler de
Notre-Dame sans évoquer Fulcanelli(2), de son nom de plume, et auteur prolixe du début du XXe siècle sur l’alchimie des lieux. L’art gothique, selon lui, viendrait d’argotique, l’argot, ce « langage particulier à tous les individus qui ont intérêt à communiquer leurs pensées sans être compris de ceux qui les entourent ». Et, en effet, de nombreux signes sont visibles sur le monument créant un langage bien spécifique. Tous ces éléments contribuent au caractère exceptionnel des lieux, mais il faudra attendre 1991 pour que la cathédrale soit inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de « chef d’œuvre architectural ». Las, l’incendie de 2019 va ruiner Notre-Dame qui va devoir se relever de ses cendres aux termes d’un chantier exceptionnel à plus d’un titre.
La dimension spirituelle du lieu et de l’ouvrage est d’une évidence absolue. L’attachement à Notre-Dame dépasse de loin les frontières de notre pays quelles qu’en soient les raisons, historiques, religieuses ou spirituelles. Notre-Dame donne aussi à voir un sens caché à l’édifice, comme l’écrivait Fulcanelli, « tout est alchimie dans Notre-Dame ». Mais ce sont surtout les murs, principalement, bien visibles des badauds, qui portent l’essentiel des messages dont la lecture alchimique permet une véritable plongée dans le Moyen Âge.
De nombreux éléments en attestent comme ce médaillon sur le trumeau du porche principal. Cette femme tient à sa main droite un livre ouvert (la connaissance accessible) et un livre fermé (la connaissance réservée aux initiés) et s’appuie sur elle une échelle à neuf degrés. Fulcanelli commentera ainsi cet élément : « Maintenue entre ses genoux et appuyée contre sa poitrine se dresse l’échelle aux neufs degrés, hiéroglyphe de la patience que doivent posséder les fidèles au cours des neuf opérations successives du labeur hermétique. La patience
est l’échelle des philosophes et l’humilité est la porte de leur jardin, car quiconque persévérera sans orgueil et sans envie, Dieu lui fera miséricorde. » Toutefois cette sculpture n’est pas médiévale mais date du XIXe siècle lors de la restauration par Eugène Viollet-le-Duc. Lui-même aurait été initié et son chemin aurait pu croiser celui de Fulcanelli selon Eugène Canseliet(3), le doute subsiste toujours.
Bien entendu, l’on peut aussi lire les vingt-quatre médaillons des piliers Nord et Sud représentant les vices et les vertus comme autant d’exemples d’alchimie spirituelle où le chercheur, dans sa quête, tente de transmuter ses défauts en leurs qualités contraires. Les « mystères » de Notre-Dame sont nombreux et ont traversé les âges mais les techniques de construction sont parfois tout aussi mystérieuses. La charpente, elle, n’est pas visible mais elle arbore aussi sa part cachée, seulement connue des initiés.
Si les dégâts de l’incendie sur la voûte et les murs sont lourds, de la charpente, dévorée par les flammes, il ne subsiste que quelques bois brûlés. La restituer dans son état d’origine est un pari un peu fou tant les obstacles sont nombreux, à commencer par les techniques en partie oubliées. Les relevés des architectes effectués en 2015 vont s’avérer cruciaux dans ce choix mais subsiste encore le défi de dessiner l’ensemble de la charpente et ses points d’assemblage, au nombre de quatre mille. Ce travail se verra confié aux Ateliers Perrault dans le Maine-et-Loire. Des ateliers bicentenaires mais modernisés qui vont cette fois faire appel à un tout autre savoir.
Ils vont alors s’associer aux Ateliers Desmonts, proches du Château d’Omonville, siège de la Grande Loge Francophone de l’A.M.O.R.C. Cette entreprise familiale s’attache à retrouver et préserver d’anciennes techniques au travers d’un réseau international,
les Charpentiers sans Frontières. L’association qui œuvre de par le monde pour perpétuer les savoir-faire anciens a permis aux Ateliers Desmonts d’enrichir leurs connaissances en matière de charpente. Une particularité qui leur vaudra cette reconnaissance sur ce chantier pas comme les autres. Mais que cherchent ces charpentiers aujourd’hui à l’heure du numérique et des outils robotisés ? Pour la plupart compagnons du devoir, parfois issus d’autres pays, ils s’attachent à retrouver l’esprit et le savoir-faire qui ont guidé leurs prédécesseurs du Moyen Âge. Pour ne pas oublier, pour garder la mémoire des techniques, des gestes, des outils, de la compréhension de la matière et pour transmettre, ensuite.
Il faut une longue expérience et une relation à la nature bien particulière pour choisir les chênes qui seront destinés à tutoyer le ciel parisien. La très large majorité provient de forêts gérées par l’ONF (Office National des Forêts) en futaies régulières, le reste de forêts privées bénéficiant du même mode de gestion. C’est Rémy Desmonts,
le créateur des Ateliers Desmonts, qui a eu la responsabilité de cette lourde tâche. C’est lui qui a dû sélectionner 1300 arbres en fonction de leurs qualités respectives, des arbres choisis au regard de leur place future dans la charpente grâce à cette connaissance si particulière, cette relation quasi symbiotique avec la forêt. Fulcanelli n’aurait sans doute pas renié cette relation alchimique entre l’homme et la nature au bénéfice de la beauté et de l’élévation.
Si la technologie se montre dans ce chantier, avec un marquage et un repérage GPS de chaque grume, l’essentiel du travail se fait comme autrefois. Il s’agit ici de bois vert, comme au Moyen Âge, le chêne sec serait impossible à travailler avec les outils utilisés. Des outils dédiés à la taille et à l’équarrissage ont dû être recréés par un groupement de forgerons taillandiers de toute la France. Là encore le savoir-faire perdu a dû être retrouvé en plongeant dans l’histoire de ces bâtisseurs du XIIe siècle. Les outils sont marqués du sceau de leurs créateurs et répondent à des noms anciens comme la doloire ou la hache à clapet.
Dans l’atelier où résonnent les coups portés par les charpentiers, ceux-ci reportent au sol les tracés de chaque élément, ce que l’on
appelle l’épure. Éléments qui viennent ensuite s’assembler « à blanc » avec tenons et mortaises et sont ajustés, toujours avec des outils d’époque. Les différentes pièces subissent alors un marquage spécifique que les charpentiers incisent dans le bois pour en faciliter ensuite le montage. Des repères semblables existaient sur la charpente originelle et sont toujours interprétables, d’autres le sont moins. Dans ce souci de restitution à l’identique, les taillandiers se sont mobilisés pour forger des outils bien spécifiques afin de reproduire les marques laissées autrefois sans que leur sens ne soit pour autant élucidé avec certitude. Il reste encore une part de mystère dans cette charpente qui aura perduré près de 800 ans !
La charpente médiévale s’identifie par un système de « chevrons- formant-ferme », soit une structure triangulaire portante. Ici, elle est de taille, quatorze mètres, et patiemment, les quarante-et-une fermes de la charpente de la nef de Notre-Dame prennent vie. Toutes sont différentes, elles suivent les murs, et certaines intègrent des systèmes de report de charge, les « aiguilles pendantes ». Taillés dans le fil du bois, tandis que sonnent les outils pareils à des cloches, les chênes parfois bicentenaires trouvent leur place dans cet incroyable édifice en bois, telle une forêt dressée vers le ciel.
Maintenant s’élève cette nouvelle charpente, restituée au plus proche du savoir des maîtres-artisans du Moyen Âge et sera surmontée de sa flèche. Cette flèche sera celle conçue par Viollet-le-Duc, bien plus haute que la flèche moyenâgeuse. Ces arbres, cette forêt vivante, vont redonner vie à cet édifice majestueux au terme d’un chantier d’une dimension exceptionnelle. N’est-ce pas déjà une incroyable alchimie que cette transformation de la matière vivante en noble édifice par les mains d’une fraternité d’hommes et de femmes en quête de perfection ?